Le Trouble du Développement Intellectuel (TDI) nécessite un accompagnement qui dépasse la réponse ponctuelle à des difficultés. Il s’inscrit dans une trajectoire évolutive, où les besoins de l’enfant changent selon son âge, ses progrès, son environnement et les contextes scolaires, familiaux ou sociaux.
C’est dans ce cadre qu’intervient le projet de soins personnalisé : un document de référence, évolutif, qui formalise l’ensemble des objectifs, des intervenants, des outils et des adaptations nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques de l’enfant.
Ce projet est essentiel pour garantir une cohérence des actions, éviter les ruptures de suivi, et placer la famille au cœur du dispositif.
Les grands principes du projet de soins
Un projet de soins individualisé s’appuie sur plusieurs fondements :
- L’approche globale de l’enfant, dans toutes ses dimensions : cognitive, affective, motrice, sociale, familiale ;
- La pluridisciplinarité, avec une coordination entre les professionnels médicaux, paramédicaux, éducatifs et scolaires ;
- La personnalisation, c’est-à-dire l’adaptation du contenu aux besoins précis de l’enfant, et non à un modèle standard ;
- L’évolution dans le temps, avec des bilans réguliers et des ajustements en fonction des progrès, des nouvelles difficultés ou des changements d’environnement ;
- L’implication de la famille, qui est associée à toutes les étapes de l’élaboration et du suivi du projet.
Quand mettre en place un projet de soins ?
Le projet de soins est généralement formalisé :
- À la suite d’un diagnostic confirmé de TDI par un professionnel qualifié ;
- Lors de l’entrée dans un dispositif de soins coordonné (ex : CAMSP, CMPP, SESSAD) ;
- En amont d’une demande auprès de la MDPH, ou d’un aménagement scolaire (ULIS, PPS, etc.) ;
- À l’initiative d’un médecin coordonnateur, d’un psychologue référent ou d’un établissement médico-social.
Il peut être initié très tôt (dès 2 ou 3 ans), et être réévalué régulièrement au fil du développement de l’enfant.
Les étapes de construction du projet
Recueil d’informations
Le projet commence par un temps d’évaluation approfondi, incluant :
- les bilans médicaux et psychométriques (QI, fonctionnement adaptatif) ;
- les évaluations orthophoniques, psychomotrices, neuropsychologiques ;
- les observations faites en crèche, à l’école ou à domicile ;
- les échanges avec les parents, qui connaissent mieux que quiconque les réactions et habitudes de leur enfant.
Définition des objectifs
Les objectifs sont formulés de manière concrète, réaliste et priorisée, en fonction :
- du niveau de développement actuel de l’enfant ;
- de ses ressources et de ses fragilités ;
- de son environnement (familial, scolaire, social) ;
- des possibilités d’intervention dans le réseau local.
Exemples d’objectifs :
- améliorer la communication fonctionnelle (mots, pictogrammes, gestes),
- développer l’autonomie dans les routines (habillage, repas, toilettes),
- renforcer la tolérance à la frustration et les compétences sociales de base,
- favoriser la scolarisation avec des adaptations appropriées.
Choix des intervenants et coordination
Le projet détermine qui fait quoi, à quelle fréquence, et avec quels moyens :
- professionnel de santé : médecin de suivi, pédopsychiatre, neuropédiatre,
- professionnels paramédicaux : orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute,
- professionnels éducatifs : éducateur spécialisé, enseignant référent, AESH,
- coordination : par un référent de parcours (souvent un professionnel CAMSP ou SESSAD).
La concertation entre les intervenants est formalisée par des réunions régulières, des synthèses écrites, et l’utilisation d’un dossier partagé (quand cela est possible).
Le rôle central de la famille
Les parents ne sont pas de simples destinataires du projet : ils en sont co-auteurs.
Le projet prend en compte :
- leurs priorités et attentes,
- leur connaissance du rythme et des réactions de l’enfant,
- leur implication possible dans certaines interventions (guidance parentale, structuration de l’environnement à la maison…).
L’écoute et la co-construction renforcent l’adhésion des familles, leur sentiment de compétence, et évitent les malentendus ou les ruptures de suivi.
Suivi et réajustements
Le projet de soins personnalisé n’est jamais figé. Il évolue selon :
- les progrès observés,
- les difficultés persistantes,
- les transitions (scolaires, sociales, familiales),
- les évaluations annuelles ou semestrielles.
Il peut être reformulé, complété ou réorienté à tout moment, avec l’accord de la famille et de l’équipe.



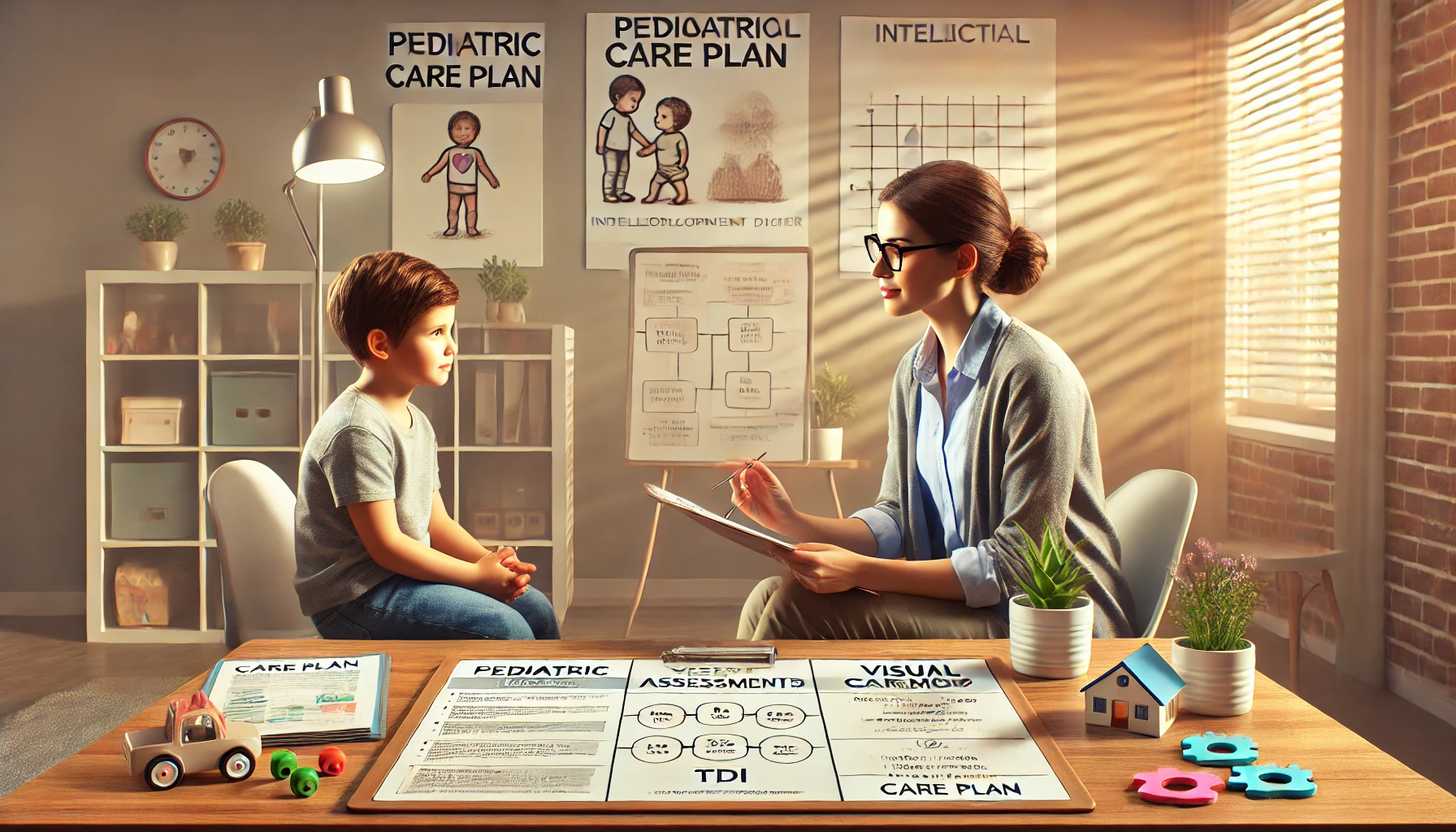
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.